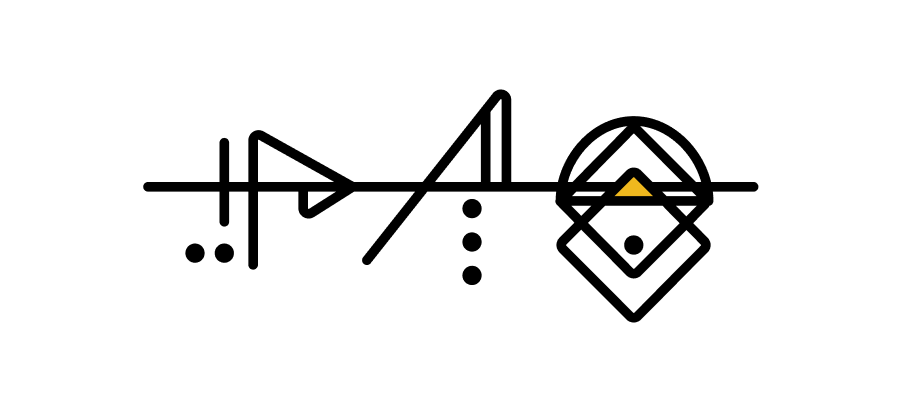Autour des intelligences - E01 - Introduction.
Dans cette série d'articles, nous explorons l'intelligence comme une capacité d'autonomie dans un environnement, et non comme une marque de supériorité. Du thermostat à l'humain, nous observons comment différentes formes d'intelligence s'adaptent à leur contexte.

Bienvenue dans le premier article d’une série dédiée à des réflexions autour des intelligences humaines et des intelligences dites artificielles. C'est une série d'hypothèses autour de ce qu'elles seraient, ce qu'elles ne seraient pas, mais aussi leurs potentiels impacts sur notre société et les différents usages dans des optiques organisationnelles. Elles ont été écrites dans le cadre d'un cours pour Excelia et je les remercie d'avoir stimulé cette réflexion 🙂
Avant de parler d'artificielle, nous allons consacrer ce premier post à la notion d'intelligence. La légende raconte que nous, Homo Sapiens Sapiens, nous, fière et insolente créature qui dominerait le règne animal et végétal depuis plus de 300 000 ans, nous, êtres créateurs, serions au paroxysme de ce concept fumeux que l'on appellerait intelligence.
Mais vous êtes-vous déjà posé la question de ce que cela voudrait dire d'être intelligent ? Certains diraient que « c'est l'art de ne pas être bête », mais bien que marchant sur 2 pattes, ayant perdu nos poils et nous cachant derrière un langage naturel plus ou moins fin, je peux vous assurer que derriere ces artifices, intelligent ou pas, nous sommes tous, moi y compris, bien des « bêtes ». Oui nous sommes bien “bêtes”.
Quand on pousse un peu ce concept, on se rend compte en fait que l'intelligence n'aurait rien à voir avec la notion d’être bête ou pas mais plus avec la notion de savoir si nous sommes autonome ou pas. L'intelligence confèrerait à une personne une capacité à se développer en toute autonomie dans un environnement plus ou moins complexe. En d'autres termes, ce serait la capacité d’une entité à se suffire à elle-même.
L'intelligence est donc corrélée à l'environnement. Plus l'environnement sera stable, constant et donc prévisible, plus l'intelligence nécessaire pour être autonome sera simple. De l'autre côté, plus l'environnement est complexe, inconstant et donc imprévisible, plus l'intelligence nécessaire pour être autonome sera complexe.
Prenons l'exemple d'un thermostat, un automate simple qui régule la température d'une pièce. Dans sa forme la plus basique, il n'utilise qu'un seul capteur de température et un algorithme simple de comparaison. La complexité du système régulateur est minimale, avec peu de calculs nécessaires pour prendre une décision binaire : allumer ou éteindre le chauffage.
Passons au robot aspirateur. Son système régulateur est plus complexe, intégrant plusieurs capteurs : détecteurs de proximité, capteurs de chute, caméras pour la navigation, et capteurs de poussière. L'algorithme de prise de décision est plus sophistiqué, nécessitant une cartographie en temps réel, une planification de trajectoire, et une gestion des obstacles. Les calculs sont plus intensifs, permettant une adaptation rapide aux changements de l'environnement.
Considérons maintenant une voiture autonome. Son système régulateur est extrêmement complexe, intégrant une multitude de capteurs : caméras, lidars, radars, GPS, et capteurs inertiels. Les algorithmes de traitement sont très avancés, utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond pour interpréter l'environnement en temps réel. La puissance de calcul nécessaire est considérable, permettant des décisions en millisecondes dans des situations de trafic complexes et imprévisibles.
Enfin, examinons l'être humain, l'automate à son paroxysme de complexité. Notre système "régulateur" est le cerveau, intégrant des milliards de capteurs (nos cellules sensorielles) capables de détecter une variété infinie de stimuli. Notre capacité de traitement est inégalée, combinant perception, mémoire, émotion, et raisonnement abstrait. Nos algorithmes de prise de décision, fruit de millions d'années d'évolution, nous permettent de nous adapter instantanément à des situations totalement nouvelles, de créer, d'innover, et même de remettre en question notre propre fonctionnement.
Cette progression dirigée nous permet de comprendre comment la complexité du système régulateur augmente considérablement avec celle de l'environnement. Au sommet de cette pyramide se trouverait, en théorie, l'intelligence humaine, capable de s'adapter et d'évoluer dans les environnements les plus imprévisibles et changeants.
Si nous devions tirer quelques hypothèses de cette premiere réflexion, on pourrait écrire les suivantes :
- En principe donc, nous serions aussi intelligent qu’une bactérie
- L’intelligence, c’est un truc normal, tous le monde l’est, sans exception, donc contrairement à ce qu’on pourrait le penser, tous le monde serait intelligent et personne ne serait vraiment c..
- L’intelligence serait corrélé à un environnement, donc certaines personnes dévoileraient leur intelligence dans des environnements sociaux, d’autres dans la mathématiques, la musique ou les jeux-vidéos. Notre cerveau se spécialise et se différencie. On pourrait parler d’intelligences différenciées d’ailleurs au lieu d’intelligences multiples mais bon, cela sera une autre discussion pour un autre article.
- Et enfin, une intelligence requiert plusieurs grands “structures” : des moyens pour récupérer des informations de l’environnement, des moyens pour pouvoir interagir avec ce même environnement et un moyen de pouvoir stocker des informations en interne.
Avant d’aller plus loin, Maintenant que vous savez un peu plus sur cette notion d’intelligence. Posez vous la question : Comment qualifieriez-vous une intelligence dite artificielle ?
Gd.